Dictionnaire étymologique des noms français et latins

Abies : Nom latin de cet arbre à étymologie inconnue.
 Le Sapin blanc
Le Sapin blancAbsinthe : Du latin 'absinthium', lui-même du grec 'apsinthion' (sans douceur) les boissons préparées à base d'absinthe étaient désagréable à boire à cause de sa grande amertume.
 L'Absinthe
L'AbsintheAcacia : Du grec 'akakia' (espèce d'épineux indéterminée).
 Le Mimosa
Le MimosaAcanthe : Du grec 'akanthos' (épine, piquant) allusion aux hampes florales et au feuillage épineux de certaines espèces.
 L'Acanthe molle
L'Acanthe molleAcer : En latin 'acer' (dur) allusion aux propriétés physiques du bois.
 L'Érable de Montpellier
L'Érable de Montpellier  L'Érable champêtre
L'Érable champêtre  L'Érable plane
L'Érable planeAceras : Du grec 'a' (privatif) et 'keras' (corne), allusion à l'absence d'éperon sur la fleur.
 L'Acéra home-pendu
L'Acéra home-penduAchillea : Nom grec de végétaux indéterminés. La mythologie nous raconte qu'Achille utilisait certaines plantes pour se guérir de ses blessures. Leur usage médicinal en Europe ne date que du XVI siècle.
 L'Achillée sternutatoire
L'Achillée sternutatoireAchillée, Achillea : Du grec 'akhileios' (herbe d'Achille), Homer raconte dans l'Iliade qu'Achille soignait les soldats avec cette herbe lors de la guerre de Troy.
 L'Achillée millefeuille
L'Achillée millefeuilleAcinaciformis : De 'acinaces' (espèce d'épée courbe utilisée en Perse) allusion à la forme des feuilles.
 La Figue des Hottentots
La Figue des HottentotsAconitum : Du grec 'akonê' (rocher), allusion au biotope de certaines espèces.
 L'Aconit anthore
L'Aconit anthore  L'Aconit napel
L'Aconit napelActaea : Du grec 'aktaia' (sureau), allusion aux fruits qui sont semblables à ceux du sureau.
 L'Actée en épi
L'Actée en épiAdenocarpus : Du grec 'adên' (glande) et 'karpos' (fruit), allusion au fait que la gousse est couverte de tubercules glanduleux.
 L'Adénocarpe à grandes fleurs
L'Adénocarpe à grandes fleursAdonis : Dédié à Adonis tué par un sanglier et transformé en fleur par Vénus à partir d'une goutte de son sang.
 L'Adonis de printemps
L'Adonis de printemps  L'Adonis flamme
L'Adonis flamme  L'Adonis annuelle
L'Adonis annuelle  L'Adonis d'été
L'Adonis d'étéAegilops : Du nom grec de la folle avoine, mais aussi de 'aïx' (chèvre) et 'ops' (oeil).
 L'Égilope à 3 arêtes
L'Égilope à 3 arêtes  L'Égilope ovale
L'Égilope ovaleAegopodium : Du grec 'aïx' (chèvre) et 'podion' (pied), allusion à I'aspect particulier des folioles.
 L'Égopode podagraire
L'Égopode podagraireAethusa : Du grec 'aïtho' (enflammer), allusion à l'âcreté et la toxicité du végétal.
 La Petite ciguë
La Petite ciguëAgave : Du grec 'agauê' (admirable, magnifique).
 L'Agave américain
L'Agave américainAgrimonia : Déformation du mot grec 'argémônê'.
 L'Aigremoine
L'AigremoineAgrostemma : Du grec 'agros' (champ) et 'stemma' (couronne), allusion à la corolle qui a la forme d'une couronne.
 La Nielle
La NielleAgrostis : Nom grec d'une herbe indéterminée.
 L'Agrostide des chiens
L'Agrostide des chiens  L'Agrostide blanche
L'Agrostide blancheAigle : Si l'on arrache une feuille développée, dont on coupe la base brune, on aperçoit, sur la face coupée, un aigle à deux têtes.
 La Fougère commune
La Fougère communeAilante : De l'indonésien 'ai' (arbre) et 'lanto' (ciel) du fait de sa hauteur (30m). Certains botanistes ont à tort écrit 'ailant(h)e' et 'ailant(h)us' avec un 'h' pensant que le mot venait du grec.
 L'Ailante glanduleux
L'Ailante glanduleuxAjuga : Du latin 'abigere' (chasser), allusion aux prétendues vertus de ces végétaux qui faciliteraient I'accouchement.
 La Bugle petit pin
La Bugle petit pin  La Bugle rampante
La Bugle rampanteAkantha : Nymphe qu'Apollon, dieu du soleil, voulut enlever, mais elle le griffa au visage. Pour se venger, il la métamorphosa en une plante épineuse.
 L'Acanthe molle
L'Acanthe molleAladèrn, Alaterne : Du latin 'alaternus' (alterne), les feuilles sont disposées de manière alterne sur les rameaux.
 Le Nerprun alaterne
Le Nerprun alaterneAlba : Du latin 'albus' (blanc, pâle).
 Le Mûrier blanc
Le Mûrier blanc  Le Rouvet blanc
Le Rouvet blanc  Le Chénopode blanc
Le Chénopode blanc  Le Mélilot blanc
Le Mélilot blanc  Le Sapin blanc
Le Sapin blanc  Le Peuplier blanc
Le Peuplier blancAlisma : Du celtique 'alis' (eau), allusion au biotope de ces végétaux.
 Le Plantain d'eau
Le Plantain d'eauAlkanna : Du nom arabe du Henné.
 L'Orcanette des teinturiers
L'Orcanette des teinturiersAlliaria : Du latin 'allium' (ail), allusion à l'odeur alliacée des feuilles froissées de ces végétaux.
 L'Alliaire officinale
L'Alliaire officinaleAllium : Du celtique 'all' (chaud), allusion aux vertus et propriétés de ces végétaux.
 L'Ail des ours
L'Ail des ours  L'Ail rose sauvage
L'Ail rose sauvage  Le Poireau sauvage
Le Poireau sauvage  L'Ail à tête ronde
L'Ail à tête ronde  La Ciboulette
La Ciboulette  Le Poireau d'été
Le Poireau d'été  L'Ail blanc
L'Ail blanc  L'Ail rocambole
L'Ail rocambole  L'Ail des vignes
L'Ail des vignes  L'Ail des montagnes
L'Ail des montagnes  L'Ail à trois angles
L'Ail à trois anglesAlnus : Nom latin de cet arbre, du celtique 'lan' (voisin des cours d'eau).
 La Bourdaine
La Bourdaine  L'Aulne glutineux
L'Aulne glutineuxAlopecurus : Du grec 'alopex' (renard) et 'oura' (queue), en rapport avec I'allure de l'épi.
 Le Vulpin des champs
Le Vulpin des champsAlthaea : Du grec 'althainô' (guérir), par allusion aux propriétés médicinales de ces végétaux.
 La Rose trémière
La Rose trémière  La Guimauve hirsute
La Guimauve hirsute  La Guimauve à feuilles de cannabis
La Guimauve à feuilles de cannabis  La Guimauve officinale
La Guimauve officinaleAlyssum : Du grec 'a' (sans) et 'lyssa' (rage), car le végétal était censé guérir cette maladie.
 L'Alysson maritime
L'Alysson maritimeAmbrosia : D'ambroisie : parfum des dieux, allusion au parfum de nombreuses espèces. Cette plante n'a cependant rien à voir avec l'ambroisie le breuvage des dieux de I'Olympe.
 L'Ambroisie à feuilles d'armoise
L'Ambroisie à feuilles d'armoiseAmpourde : Dérivé de l'occitan 'lamporda', lui-même du latin 'lappa' (nom donné à la bardane), les deux plantes ont des fruits similaires à épines crochues.
 La Lampourde glouteron
La Lampourde glouteronAmygdalus : Du grec 'amygdalos' (amandier).
 L'Amandier
L'AmandierAnagallis : Nom grec du mouron.
 Le Mouron d'eau
Le Mouron d'eau  Le Mouron femelle
Le Mouron femelle  Le Mouron rouge
Le Mouron rougeAnagyris : Du grec 'anagyros' (argué en arrière), allusion à I'allure du fruit.
 L'Anagyre fétide
L'Anagyre fétideAnchusa : Du grec 'angkeïn' (resserer) allusion à ses propriétés médicinales.
 La Buglosse d'Italie
La Buglosse d'ItalieAndrosaemum : Du grec 'anêr' (homme) et 'haïma' (sang), allusion a la couleur de certains fruits.
 Le Millepertuis androsème
Le Millepertuis androsèmeAndryala : Du grec 'anêr' (mâle) et 'hyalos' (transparent).
 L'Andryale sinueuse
L'Andryale sinueuse  L'Andryala à feuilles entières
L'Andryala à feuilles entièresAnemone : Du grec 'anemos' (vent), allusion au fait que plusieurs espèces aiment les expositions ventées.
 L'Anémone des jardins
L'Anémone des jardins  L'Anémone à fleurs de narcisse
L'Anémone à fleurs de narcisse  L'Anémone des bois
L'Anémone des bois  L'Anémone fausse renoncule
L'Anémone fausse renoncule  La Pulsatille
La PulsatilleAngelica : Du latin 'angelus' (ange), allusion aux vertus attribuées à ce végétal.
 L'Angélique des bois
L'Angélique des bois  L'Angélique officinale
L'Angélique officinaleAngustifolia : Du latin 'angustus' (étroit) et 'folium' (feuille).
 La Filaire à feuilles étroites
La Filaire à feuilles étroites  La Lavande vrai
La Lavande vrai  L'Olivier de bohème
L'Olivier de bohème  La Centranthe à feuilles étroites
La Centranthe à feuilles étroites  La Clématite petite flamme
La Clématite petite flamme  La Lavande des Pyrénées
La Lavande des PyrénéesAnthemis : Du grec 'anthemon' (fleur).
 L'Anthémis des champs
L'Anthémis des champs  L'Anthémis fétide
L'Anthémis fétide  L'Anthémis maritime
L'Anthémis maritimeAnthriscus : Du grec 'anthryskon' (cerfeuil sauvage).
 Le Cerfeuil sauvage
Le Cerfeuil sauvageAntirrhinum : Du grec 'rhis' (museau) et anti (tel).
 Le Grand muflier
Le Grand muflierAparine : Du grec 'apairo' (qui s'agrippe).
 Le Gaillet gratteron
Le Gaillet gratteronAphyllanthes : Du grec 'aphyllos' (sans feuille) et 'anthos' (fleur), allusion au fait que les fleurs ne sont pas présentes avec les feuilles.
 L'Aphyllante de Montpellier
L'Aphyllante de MontpellierApifera : Du latin 'api' (abeille).
 L'Ophrys abeille
L'Ophrys abeilleApium : Nom latin du céleri. Du celtique 'apon' (eau), allusion au biotope de ces végétaux.
 L'Ache des marais
L'Ache des marais  Le Persil cultivé
Le Persil cultivéAptenia : Du grec 'apten' (sans aile) allusion au fruit qui ne procède pas d'aile.
 Le Ficoïde à feuilles en coeur
Le Ficoïde à feuilles en coeurAquilegia : Du latin 'aquilegium' (réservoir), allusion à la forme en cornet des pétales.
 L'Ancolie commune
L'Ancolie communeArbousier : Du celte 'arbois' (bois austère).
 L'Arbousier
L'ArbousierArctium : Du grec 'arktos' (oursin), allusion au fait que la plante est couverte de poils ou d'épines.
 La Grande bardane
La Grande bardaneArifolium : En latin (à feuilles d'arum).
 L'Oseille commune
L'Oseille communeAristolochia : De 'aristos' (excellent) et 'locheia' (accouchement), en référence à ses utilisations médicinales.
 L'Aristoloche arrondie
L'Aristoloche arrondie  L'Aristoloche clématite
L'Aristoloche clématite  L'Aristoloche pistoloche
L'Aristoloche pistolocheArmeniaca : Du latin 'armenia', allusion à la patrie de cet arbre.
 L'Abricotier
L'AbricotierArmoracia : Ancien nom latin de ce végétal.
 Le Raifort
Le RaifortArrucat : De l'occitan 's'arrucar' (se recroqueviller), la rosette coupée se recroqueville en arrière.
 L'Arrucat
L'ArrucatArtemisia : Nom grec de ces végétaux, de la déesse Artémis à qui ces végétaux étaient consacrés.
 L'Absinthe
L'Absinthe  L'Armoise commune
L'Armoise commune  L'Aurone
L'Aurone  Le Génépi noir
Le Génépi noirArum : Du nom égyptien de ce végétal.
 L'Arum tacheté
L'Arum tacheté  L'Arum d'Italie
L'Arum d'Italie  Le Bouillon blanc
Le Bouillon blancAruncus : Du grec 'êrungos' (panicaut).
 La Barbe de bouc
La Barbe de boucArundo : Nom latin du roseau et du celtique 'aru' (eau).
 La Canne de Provence
La Canne de ProvenceArvensis : En latin (des champs).
 Le Liseron des champs
Le Liseron des champs  La Moutarde sauvage
La Moutarde sauvage  La Prêle des champs
La Prêle des champs  Le Mouron rouge
Le Mouron rouge  Le Souci des champs
Le Souci des champs  L'Anthémis des champs
L'Anthémis des champs  L'Aspérule des champs
L'Aspérule des champs  La Menthe des champs
La Menthe des champs  Le Tabouret
Le TabouretAsarum : Du grec 'ase' (dégoût), allusion probablement faite à I'odeur que dégage la plante.
 L'Asaret d'Europe
L'Asaret d'EuropeAsparagus : Du nom grec 'asparagos' qui définissait ce végétal.
 L'Asperge sauvage
L'Asperge sauvageAspera : Du latin 'asper' (âpre, rude, rugueux).
 La Salsepareille
La SalsepareilleAsperula : Du latin 'asper' (âpre, rude, rugueux), allusion aux poils raides de plusieurs espèces.
 L'Aspérule des champs
L'Aspérule des champs  L'Aspérule odorante
L'Aspérule odoranteAsphodelus : Du grec 'asphodelos' nom déjà donné à la plante (fer de pique) allusion à la forme des feuilles.
 L'Asphodèle fistuleux
L'Asphodèle fistuleux  L'Asphodèle ramifié
L'Asphodèle ramifiéAsphodelus : Nom grec de ce végétal consacré aux divinités infernales et aux morts qui étaient censés en consommer les tubercules, on imaginait les champs Élysée tapissés de prairies d'asphodèles.
 L'Asphodèle ramifié
L'Asphodèle ramifié  L'Asphodèle fistuleux
L'Asphodèle fistuleuxAsplenium : Du grec 'asplenon' (rate), en fonction des vertus anciennement attribuées à Ia plante pour soigner cette glande.
 La Capillaire des murailles
La Capillaire des muraillesAsteriscus : Du grec 'asterisho' (étoile) Allusion aux longues bractées vertes et pointues disposées en étoile autour des capitules.
 L'Astérolide épineuse
L'Astérolide épineuseAstragalus : Du grec 'astragalos' (osselet).
 L'Astragale de Montpellier
L'Astragale de MontpellierAthamanta : D'Athamas : plaine et montagne de Thessalie.
 L'Athamante de Crète
L'Athamante de CrèteAtriplex : Nom latin de cette plante.
 L'Arroche marine
L'Arroche marine  L'Arroche des jardins
L'Arroche des jardinsAtropa : D'Atropos, une des trois Parques qui coupait la vie.
 La Belladone
La BelladoneAtropurpurea : Du latin 'ater' (noir) et 'purpureux' (pourpre), pourpre sombre.
 La Scabieuse maritime
La Scabieuse maritimeAucuba : Nom japonais du végétal.
 L'Aucuba du Japon
L'Aucuba du JaponAustral : Du latin 'autralis' (du midi).
 Le Polypode austral
Le Polypode austral  Le Salsifis austral
Le Salsifis austral  Le Micocoulier de Provence
Le Micocoulier de Provence  La Tulipe du Midi
La Tulipe du Midi  Le Roseau commun
Le Roseau communAzerolier : De l'espagnol 'acerola' lui-même de l'arabe 'az-zou'roûr' ou 'az-zucrur'.
 L'Azérolier
L'Azérolier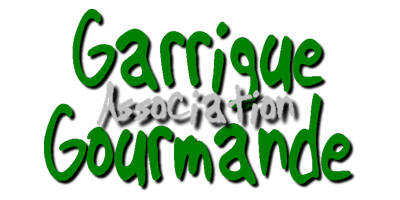



























Propulsé par CComment